L'HISTOIRE : République Tchèque. Un SDF appelé Nomak se rend dans une banque du sang, laquelle semble peu regardante sur la façon de s'approvisionner en donneurs. Toutefois, son phénotype semblant curieux, c'est à une véritable séance de torture que les laborantins vampires le destinent. Et là, une méchante surprise les attend. Pendant ce temps, Blade met fin à deux longues années de quête pour arracher son coéquipier Whistler aux griffes des vampires qui l'ont fait muter. Mais à peine les choses semblent-elles revenues dans l'ordre que deux émissaires d'Eli Damaskinos, chef suprême des vampires, pénètrent son repaire afin de lui transmettre une demande de trêve. Créature mutante véhiculant le virus du Faucheur, Nomak est en effet devenue la menace numéro un, car lui et ses victimes contaminées se nourrissent aussi bien d'êtres humains que de vampires. Blade accepte alors de prendre la tête du Peloton Sanguin, entraîné au départ pour l'éliminer...
MON AVIS : Blade premier du nom ayant avantageusement posé les bases, le deuxième se devait forcément d'aller plus loin: meilleurs effets numériques, combats plus nombreux, esprit Comics encore plus affirmé... Mais ce n'est pas tout. Car avec Guillermo Del Toro aux commandes, c'est également sous le signe du mélange des genres, de la richesse picturale et de l'horreur que Blade II se place. Le réalisateur espagnol, d'ailleurs écarté par les producteurs dans un premier temps, n'aura en effet cessé de batailler tout au long du tournage afin d'imposer la touche d'effroi qui faisait défaut au premier volet (les efforts de conviction qu'il aura dû déployer envers les producteurs lui ont d'ailleurs inspiré une blague sarcastique, inscrite au bas du générique de fin: No real reapers were hurt during the making of this film).
Le moins que l'on puisse dire, c'est que Guillermo Del Toro n'est pas homme avare en idées excitantes et heureuses. Autant le premier opus de Blade pouvait sembler monolithique dans sa façon de présenter les particularités d'une nouvelle histoire, autant ici le foisonnement semble être la règle, quitte à donner au bout du compte la sensation d'assister à un patchwork de style et de genre pas toujours abouti.
L'hybridation, après tout, s'imposait au vu de l'argument principal de Blade II, avec cette nouvelle race de sur-vampire aux gènes mutants (ou mutés) et l'obligation pour le héros de pactiser avec ses ennemis attitrés. Même au niveau de la bande originale, la quasi totalité des scores est composée de rencontres entre des groupes dont les styles n'auraient pas pu coïncider à première vue. Remarque identique pour les combats qui essaiment le film, variant les techniques selon la tonalité désirée grâce à trois chorégraphes différents (dont Wesley Snipes lui-même et Donnie Yen, qui joue l'un des membres du Peloton Sanguin). Arts martiaux avec ou sans arme, gunfights, combat de rue, boxe et même catch, tout l'art de la guerre défile sous nos yeux, avec tantôt avec un entrain joueur, tantôt une sombre sauvagerie, jusqu'au final d'une brutalité impressionnante, mixant couleur flamboyante et nervosité de la caméra portée.
Tout n'est pas parfait dans ces scènes d'action d'une durée et d'une inventivité pourtant bien supérieures à celle du film de Stephen Norrington. Les effets spéciaux ne sont pas en cause, même si certains sont encore visibles (à la fin du combat ninja, par exemple). Mais on a parfois l'impression que Del Toro n'est pas convaincu de leur pertinence et qu'à défaut d'y croire, il s'amuse à remplir la scène imposée de figures de styles brillantes et superficielles. Une impression qui disparaît complètement lors des affrontements entre Blade et Jared Nomak, chacun des deux combattants étant chargé d'un enjeu dramatique qui donne du corps, de l'émotion et du sens à chacun des coups qu'ils échangent.
Au niveau du graphisme et des ambiances, la bonne nouvelle est que nous sommes bel et bien sur la planète Guillermo Del Toro. Dès la première scène, on constate que la sophistication de Blade a aussi fait place à un univers plus sombre, moins propre, distillant angoisse et épouvante. Et il n'est que de voir la bataille orgiaque de la boîte de nuit des vampires masochistes, ou celle des égouts remplis d'ossements, pour constater que le high-tech côtoie cette fois le glauque et le macabre. L'innovation majeure reste bien sûr celle des Faucheurs: crânes chauves, déplacements simiesque, brutalité sans frein, leur floraison buccale est d'une hideur impressionnante. Le chef suprême des vampires, Damaskinos, avec sa fille Nyssa est une occasion pour Del Toro de développer, de façon malheureusement très brève, un graphisme somptueux (le bain de sang, le bureau rempli d’œuvres d'art, la colonne des bocaux...). Personnellement, je rêve déjà d'un space opera signé Del Toro...
Malgré les figures imposées (la pseudo-histoire sentimentale entre Blade et Nyssa) auxquelles il fallait s'attendre avec ce qui reste tout de même une commande, il est donc stupéfiant de constater à quel point le réalisateur a pu transporter avec lui tant d'éléments présents dans ses précédents films, et qui sont les marques de son univers. De près ou de loin, on saisit par exemple des lignes de filiation entre le dépliage organique des Faucheurs et ceux des insectes de Mimic, entre les expériences de Damaskinos et l'histoire de Cronos...
On retrouve aussi le jeu des couleurs cobalt et ambrées, ou encore la présence de Ron Perlman, qui reviendra en force dans Hellboy. Inutile de préciser, d'ailleurs, l'argument de poids qu'a dû jouer Blade II pour décider les producteurs à financer le rêve de Guillermo Del Toro !
Voilà en somme un divertissement de haute volée, même si le héros principal n'y est toujours pas le plus intéressant ! Car si Wesley Snipes est bien sympathique, son charisme est tout de même bien pâle à côté de celui que dégage Luke Goss, d'une énergie et d'une conviction proprement stupéfiantes... Peut-être aurait-il mieux valu faire un Nomak II qu'un Blade III ?
Titre français : Blade 2
Titre original : Blade 2
Réalisateur : Guillermo del Toro
Scénariste : David Goyer
Musique : Marco Beltrami
Année : 2002 / Pays : Usa, Allemagne
Genre : Vampires, super-héros / Interdiction : -12 ans
Avec : Wesley Snipes, Luke Goss, Ron Perlman, Kris Kristofferson, Leonor Varela,
Norman Reedus...





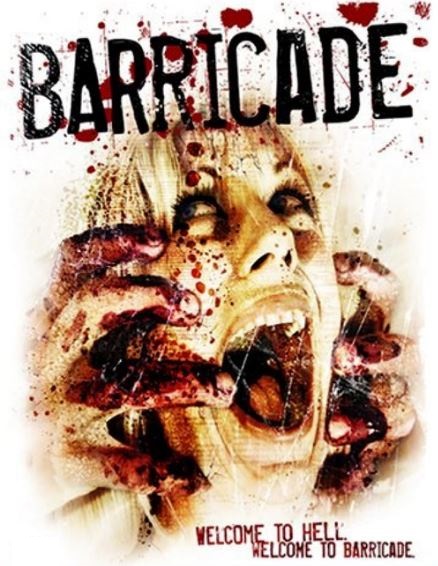
















.jpg)
.png)




